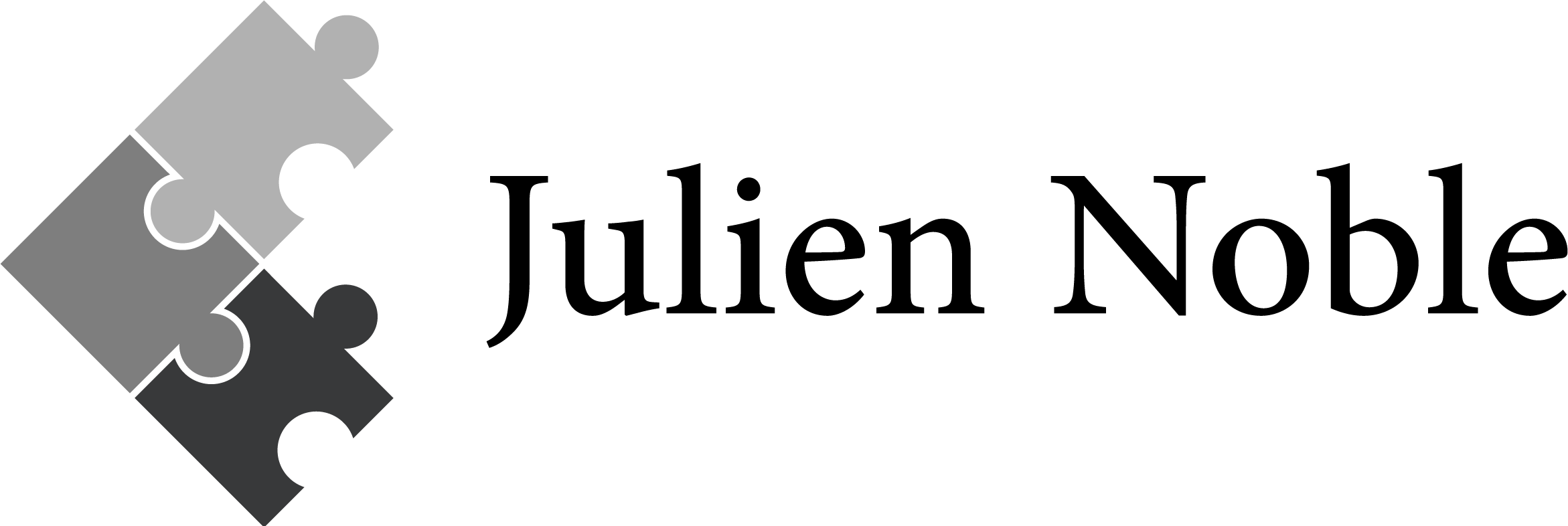Publications scientifiques

Patterns of Fear of Crime: A mixed-methods exploration of the model of experiential and expressive fear of crime
Avec Antoine Jardin (Ingénieur de recherches CNRS)
2025
PLOS One
Des centaines de travaux ont été publiés sur la peur du crime. Mais rares sont les modèles qui proposent un cadre unifié de ce phénomène social. C’est l’ambition du modèle de la peur liée à l’expérience et de la peur expressive (EEF) élaboré au milieu des années 2000 par une équipe de chercheurs britanniques. Toutefois, malgré ses nombreux apports, ce modèle original se confronte à deux limites. D’abord, les différentes versions du modèle présentent certaines divergences. Ensuite, les méthodes statistiques mobilisées reposent systématiquement sur un raisonnement hypothético-déductif qui risque de manquer l’existence de certaines combinaisons de variables. L’objectif de cet article est de revisiter ce modèle en combinant deux familles de méthodes statistiques différentes : l’analyse des configurations multivariées et l’analyse de régression logistique. La première analyse tente de dépasser ces deux limites en adoptant une approche inductive qui consiste à étudier la structure multidimensionnelle des données sans projeter sur elles des structures a priori. Elle permet d’identifier quatre classes d’enquêtés qui s’inscrivent chacune dans un rapport spécifique à la peur liée à l’expérience et à la peur expressive. Si les ‘non-inquiets’ et les ‘inquiets-dysfonctionnels’ associent ces deux dimensions de la peur du crime, les ‘anxieux’ et les ‘inquiets-fonctionnels’ les dissocient très nettement. En adoptant un raisonnement inférentiel, la seconde analyse cherche à déterminer les facteurs sociodémographiques des différentes classes. Elle montre que les prédicteurs varient d’une classe à l’autre et qu’aucune variable (pas même le sexe) n’est un prédicteur pour l’ensemble des classes. Ces résultats invitent à dépasser la conceptualisation dichotomique (‘worried’ / ‘not worried’) encore largement utilisée dans l’étude de la peur du crime. Identifier systématiquement ces différentes classes pourrait également permettre de lutter plus efficacement contre la peur du crime en déployant de manière ciblé des politiques publiques adaptés.

Enquêter sur l'insécurité et la victimation : une comparaison systématique des grands instruments français
Avec Antoine Jardin (Ingénieur de recherches CNRS)
2024, 48/3
Déviance & Société
Les enquêtes de victimation constituent le principal moyen d’étudier le volume et l’évolution de la délinquance. Mais, en France, l’étude de la victimation s’est trouvée perturbée par la suppression de l’enquête INSEE CVS en 2022. Pour préserver l’observation des tendances sur le long terme, cet article propose une comparaison systématique des principaux dispositifs d’enquêtes d’ampleur nationale et de leurs résultats pour la période 2019-2022. À partir de méthodes factorielles et d’analyses de régression, il met en évidence les spécificités de chaque instrument et les similarités qui se dégagent d’une analyse de la structure des réponses. La carte factorielle enrichit notre connaissances des enquêtes de victimation et ouvre de nouvelles perspectives pour la reconstitution de séries temporelles composites mêlant plusieurs enquêtes.

Mapping Fear of Crime: Defining Methodological Orientations
Avec Antoine Jardin (Ingénieur de recherches CNRS)
2024, 58
Quality & Quantity
Le développement des nouvelles technologies a encouragé ces dernières années le déploiement de dispositifs visant à géolocaliser l’insécurité personnelle. Toutefois l’émergence de cette pratique ne s’accompagne pas de travaux méthodologiques, dont l’objectif consiste à évaluer la capacité des instruments de mesure à traduire efficacement une expérience sociale en événement quantifiable. En s’appuyant sur les résultats de l’enquête « Sentiment d’insécurité dans les transports collectifs franciliens » et sur les réponses d’étudiants interrogés dans le cadre d’une enquête complémentaire, cette étude montre que les instruments visant à localiser géographiquement l’insécurité personnelle se confrontent à deux difficultés majeures. La première tient à la diversité des émotions éprouvées et à celles des situations rencontrées. La seconde est liée à la remémoration des expériences vécues. La discussion qui conclut l’article propose des orientations méthodologiques pour l’avenir.

Ways of Perceiving Safety: From Interpretative Registers to Mechanisms of Interpretation
2023, 44/11
Deviant Behavior
Dans l’étude de la peur du crime, la perception de sécurité à l’égard du risque de victimation est souvent appréhendée comme la simple conséquence de l’absence de risque perçu. Au contraire, cet article soutient l’hypothèse d’un phénomène complexe qui repose sur différents registres interprétatifs. L’exploitation d’une trentaine d’entretiens réalisés auprès d’étudiants d’une université française révèle trois manières différentes de se percevoir en sécurité (la fragilité, l’assurance et la tranquillité), s’inscrivant chacune dans un rapport spécifique à soi et aux agresseurs présumés. Fort de cette démonstration, l’article s’intéresse ensuite aux conditions d’émergence et d’évolution de ces interprétations. Loin d’être attachées aux personnes, les interprétations fluctuent selon les situations rencontrées et les expériences passées, d’où l’importance accordée par l’article à mettre en lumière les deux dimensions synchronique et diachronique du phénomène interprétatif.

From Victimization to fear: Fear of crime and its variations among victims
Avec Antoine Jardin (Ingénieur de recherches CNRS)
2020, 60/2
The British Journal of Criminology
La relation entre la victimation et la peur du crime est traditionnellement étudiée par croisement binaire. Ainsi les auteurs regardent si le fait d’être victime d’une atteinte augmente le risque d’avoir peur, mais sans jamais tenir compte de la diversité des profils de victimation. En vue d’intégrer cette variable, on propose de travailler sur une population de victimes de vol et d’agression – grâce au cumul des données d’une enquête de victimation française régulièrement reconduite – et de classifier ces individus selon le type et le relief de l’atteinte subie. On s’intéresse ensuite à la relation entre la peur du crime et ces différents profils. Les résultats montrent qu’il n’existe pas une relation unique et homogène mais une diversité de configurations entre ces deux variables.

L'insécurité personnelle et ses variations: pour une analyse dispositionnelle
2016, 40/3
Déviance & Société
À l’aide du dispositionalisme, cet article propose un modèle théorique pour expliquer les variations individuelles en matière de perception du risque de victimation. La première partie porte la focale sur les travaux antérieurs. Elle présente les apports et les difficultés des principales approches explorées pour appréhender l’insécurité personnelle. La seconde partie expose le concept de « dispositions à l’insécurité personnelle ». L’ambition est de proposer une lecture de ce phénomène social au regard du dispositionalisme de Lahire. On insiste alors sur la passé incorporé des individus, façonné sur la base des expériences menaçantes, des représentations du danger et des caractéristiques individuelles, pour rendre compte de leurs réactions dans les situations présentes.

Cet article analyse les caractéristiques de la peur du crime dans les transports en commun. Basé sur les études réalisées sur ce thème, il identifie trois catégories de facteurs induisant ce phénomène. La première, de nature sociale, insiste sur la perception du risque suscitée par l’isolement et certaines catégories d’usagers. La seconde est liée aux modalités de fonctionnement des transports en commun, dont certaines caractéristiques renforcent la peur des voyageurs. La troisième porte sur l’architecture et plus spécifiquement sur le cloisonnement et ses différents effets selon le nombre d’usagers.